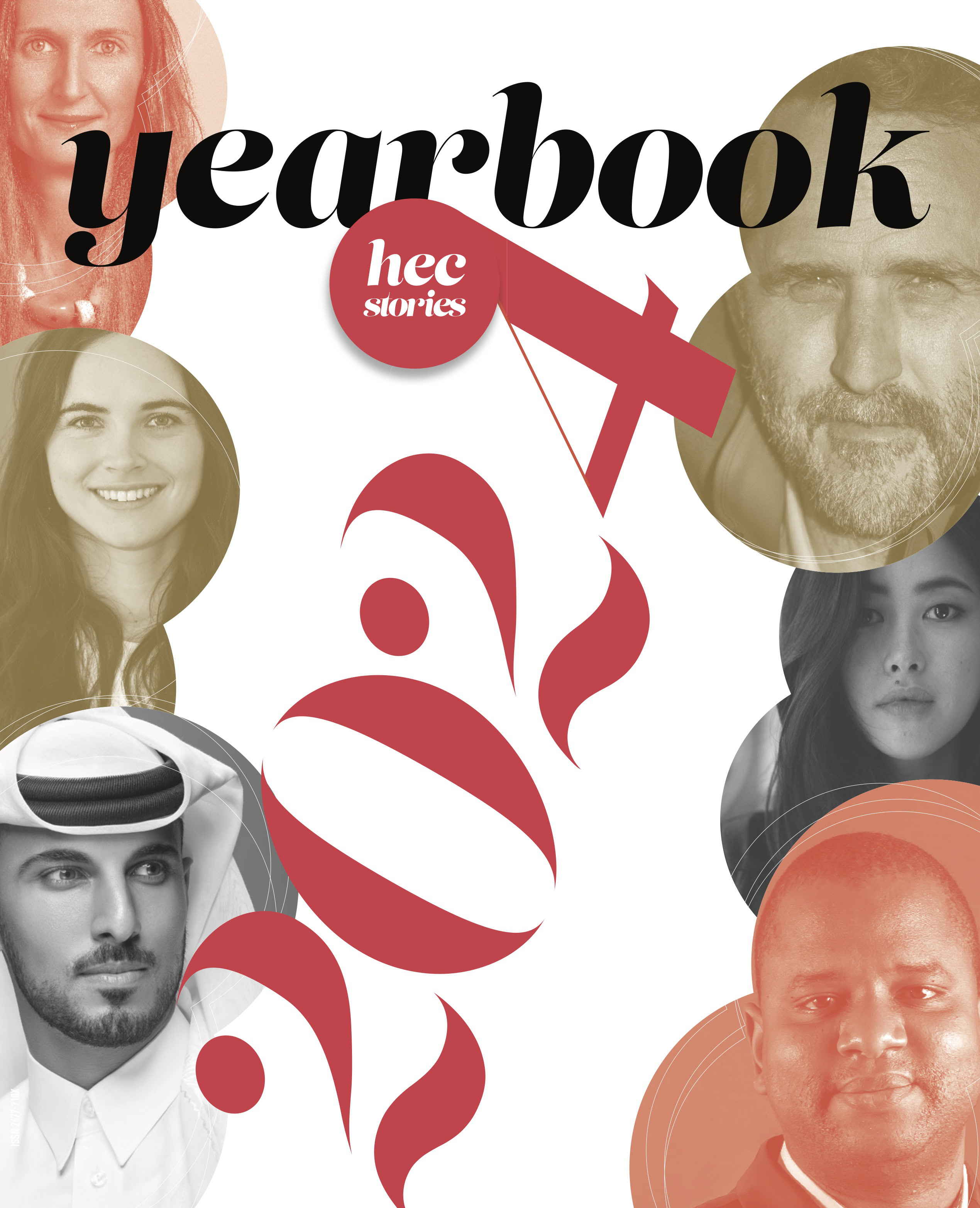Thierry Blandinières (InVivo) répond aux étudiants HEC

“Jardiland, Baguépi, Pomme de pain, Frais d’ici : ces marques parleront probablement à nos lecteurs français. Pourtant, le groupe qui les détient reste méconnu. InVivo fait partie des poids lourds de l’agroalimentaire mondial avec un chiffre d’affaires avoisinant les 10 milliards d’euros (dont la moitié est réalisée à l’international) et 90 sites industriels, dont 63 en France. L’union de coopératives a doublé de taille en décembre, avec le rachat de son compatriote Soufflet, notamment actif dans la production de malt, la meunerie ou les produits de protection de la vigne. Cette acquisition renforce la stratégie de diversification d’InVivo qui s’est déjà développé dans de nombreuses activités telles que la viticulture, la jardinerie ou la distribution. Une stratégie payante, même si elle s’est accompagnée d’échecs – comme celui du pôle Food & Tech chargé de créer de nouveaux business models numériques qui a fermé en 2020 après trois ans d’activité.
À la tête d’InVivo depuis 2013, Thierry Blandinières (E.03) a rencontré trois étudiants HEC sur le rooftop du siège parisien, au 83, avenue de la Grande-Armée. La serre et le potager attenants ont tout de suite donné une couleur particulière aux échanges. En pleine guerre en Ukraine, il a été question de souveraineté nationale et européenne en matière d’alimentation. Comment réduire la dépendance à des pays comme le Brésil ou à la Russie tout en se conformant au modèle vertueux de production exigé par l’Union européenne, la fameuse stratégie « De la fourche à la fourchette » ? Le patron d’InVivo ne cache pas ses doutes sur le bio et prône une troisième voie, une agriculture de précision qui réduit au strict minimum les intrants et permettrait ainsi de produire massivement tout en limitant l’impact environnemental. Une démarche prometteuse, mais qui reste à industrialiser.
L’agriculture face à des choix structurants
Régis Gnonlonfoun (MBA.23): L’agriculture était un moteur de l’économie française dans les années 1970. Quelle stratégie préconisez-vous pour accroître sa compétitivité ?
Thierry Blandinières (E.03) : À la période que vous évoquez, l’agriculture occupait en France une position économique prépondérante. Ce fut un des piliers de la construction européenne, avec le charbon et l’acier. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’enjeu était de produire suffisamment pour nourrir le Vieux Continent. Cela est passé par le machinisme agricole, puis par la chimie. On a appelé ces innovations la deuxième révolution agricole. La troisième, contemporaine, repose sur le numérique, les biotechnologies et les nouvelles techniques culturales. La conséquence de ces progrès est que l’agriculture a pris une place plus discrète dans la société. L’alimentation a été considérée comme un acquis, une variable d’ajustement du pouvoir d’achat, représentant une part décroissante du budget des ménages. Les agriculteurs ont un défi à relever, ils doivent continuer d’innover afin de produire bon et pas cher. Car les consommateurs recherchent avant tout des prix bas. Regardez le développement du bio. Au-delà d’un certain prix, il n’y a plus de marché. D’ailleurs, la filière laitière, qui était en avance sur le bio, voit son marché se retourner et fait un pas en arrière sur ses ambitions. Et l’inflation liée à la guerre en Ukraine va encore compliquer les choses. D’autant que la loi EGalim, qui vise à assurer aux agriculteurs un revenu digne, tire les prix vers le haut et impose 20 % de produits bio dans la restauration collective. Pour répondre à votre question sur la compétitivité, je pense qu’il faut avant tout assurer la sécurité économique de notre agriculture. Et pour cela, il faut de grandes cultures qui nourrissent le bétail. Nous devons disposer d’une alternative au soja brésilien dont nous sommes énormément dépendants. Le gouvernement a lancé le plan « Protéines végétales » dans cette optique. Les semences constituent le socle de l’agriculture mondiale. Une fois cette étape accomplie, il faudra construire des filières pour nous permettre de nous approvisionner localement. Notez que les grandes cultures jouent un rôle de puits de carbone et réduisent ainsi les quantités de CO2 contenues dans l’atmosphère. Elles font partie des solutions clés pour lutter contre le réchauffement climatique. Pourtant, elles ne sont pas comptabilisées dans le bilan carbone national. Une précision : pour constituer un puits de carbone, il faut au préalable disposer de sols de qualité.
Valentin Gesquière (H.23): Vous considérez la souveraineté alimentaire de la France et plus largement de l’Europe comme une priorité. Est-ce possible ?
Thierry Blandinières (E.03) : En quelques années, l’épidémie de Covid-19 et la crise ukrainienne ont ramené l’agriculture au centre des préoccupations. Elles nous ont fait prendre conscience de l’importance de maîtriser notre chaîne alimentaire. La France a une agriculture forte, avec des segments souverains mais aussi d’autres qui dépendent fortement des importations. Par rapport à d’autres industries, comme la technologie ou l’automobile, le secteur primaire s’en sort globalement bien. Depuis trente ans, la France a détruit une grande partie de son industrie, repoussant la production dans des pays émergents où les coûts étaient moins élevés. Nous avons voulu nous focaliser sur les services à valeur ajoutée, et nous nous sommes rendus dépendants d’autres pays pour certains fondamentaux de l’économie. La crise russe nous le rappelle cruellement en ce qui concerne les matières premières. Concernant l’agriculture, il est possible de produire davantage, mieux et de manière plus durable. Ce n’est pas qu’une posture politique, c’est une réalité.
Valentin : La nouvelle PAC (politique agricole commune) de l’Union européenne vous semble-t-elle aller dans le bon sens ?
Thierry Blandinières (E.03) : Je pense comme le président Emmanuel Macron qu’il faut infléchir le programme « De la fourche à la fourchette », car il est synonyme de décroissance. La feuille de route européenne prévoit de passer à 25 % la part de l’agriculture biologique d’ici à 2035. Or la première étude d’impact solide a été réalisée par… le département américain de l’agriculture. Ils ont fait leurs calculs et conclu que le plan allait réduire de 10 % la production de la « ferme Europe » à horizon 2030. Les États-Unis voient ça d’un très bon œil, puisqu’ils pourront exporter davantage vers notre continent ! La raison de cette décroissance anticipée est simple : quand vous passez au bio, les rendements diminuent de 40 % en moyenne ; 40 % sur un quart de la production, cela donne une baisse de 10 %. Est-ce que l’Europe souhaite diminuer d’autant sa production agricole, a fortiori dans un contexte d’inflation ? Veut-elle se rendre encore plus dépendante de l’Ukraine, du Brésil ou des États-Unis ? Évitons les postures trop radicales. Plutôt que mettre le bio au cœur de la transformation, je préconise un engagement à réduire les pesticides et les engrais de 35 %. Une production durable plutôt que bio. J’entends par durable une agriculture qui prend en compte et favorise la qualité des sols. Cela n’empêche pas de faire du volume en bio partout où vous avez un potentiel agronomique qui le permet. Je pense surtout au sud de l’Europe et à la Méditerranée.

Valentin : Vous évoquez la Méditerranée. La souveraineté alimentaire se joue-t-elle au niveau européen ou dans une zone plus étendue?
Thierry Blandinières (E.03) : L’Europe doit se rapprocher des pays d’Afrique, qui dépendent de nos exportations céréalières. Je pense à l’Algérie, au Maroc, à la Côte d’Ivoire. Il existe un risque que ces clients se détournent de l’Europe pour se tourner vers la Russie.
Valentin : Tous les agriculteurs avec qui j’échange sont unanimes, les rendements diminuent d’année en année. Comment assurer la pérennité des exploitations dans ces conditions ?
Thierry Blandinières : Nous devons progresser sur ce sujet. La monoculture appauvrit les sols des grandes exploitations. Elle oblige à mettre toujours plus d’engrais. L’alternative consiste à organiser des rotations de cultures différentes. C’est tout l’enjeu de la transition agricole : produire au même endroit du blé, du colza, du tournesol, des légumineuses… sur la base de rotations tous les cinq ans. Ainsi, les sols s’enrichissent mécaniquement. Cela permet de créer un cercle vertueux et d’augmenter les rendements.
Mathilde Deglaire (H.22): Cette question de la fertilité des sols est préoccupante. Vous parlez de rotation des cultures. On connaît cette option depuis longtemps et, pourtant, les choses n’avancent pas vraiment. Le lobbying des groupes chimiques à Bruxelles nous empêche-t-il de progresser ?
Thierry Blandinières : Je connais bien les groupes BASF, Bayer ou Monsanto. Doit-on les voir comme des groupes de pression ? Ils veulent vendre leurs produits, bien sûr. Ils effectuent du lobbying pour faire homologuer leurs molécules, de la même façon que les laboratoires pharmaceutiques sur le marché des médicaments. Cela dit, la réglementation dans la plupart des pays européens est très stricte. Les molécules sont testées avant d’être homologuées, ce qui prend du temps. Par ailleurs, l’influence des groupes chimiques doit être relativisée, car les syndicats agricoles et la PAC pèsent aussi énormément sur les décisions politiques. Ils font office de contrepouvoirs face aux entreprises privées. Et puis, vous savez, la vraie pression vient du consommateur. Nous devons adapter notre production à leurs attentes.
Nous investissons dans l’alternatif comme le biocontrôle
Mathilde: La spéculation sur les cours du blé ou des céréales nuit aux agriculteurs et aux consommateurs, ne faudrait-il pas l’interdire ?
Thierry Blandinières : On ne peut pas faire grand-chose contre la mondialisation et la monétisation des commodités, qui vont dans le sens de l’histoire. Quelle que soit la productivité de la ferme France, elle dépend des cours sur les Bourses mondiales. Il y a toujours eu un commerce international de céréales, d’abord sous forme de troc puis d’échanges monétaires, avec plus récemment la financiarisation des échanges, dont une partie relève de la spéculation. Ces cours mondiaux traduisent les tensions géopolitiques. L’invasion de l’Ukraine par la Russie provoque une inflation alimentaire qui devrait atteindre 12 à 15 % dans quelques mois en Europe. Il faut remonter aux années 1970 pour retrouver ce niveau d’inflation. La grande distribution fait son possible pour absorber les hausses, mais c’est compliqué. Le pouvoir d’achat des ménages va être fortement impacté, d’autant que la proportion de dépenses contraintes, comme le loyer, par exemple, n’a pas cessé d’augmenter ces dernières années.
Régis: J’ai participé à un projet R&D dans l’aquaponie, une méthode d’agriculture urbaine. Il existe d’autres pratiques innovantes, comme les fermes urbaines, qui sont durables, vertueuses, mais pas assez reconnues ni valorisées.
Thierry Blandinières : Tout à fait. Certains producteurs s’engagent à ne mettre aucun résidu de pesticides dans votre assiette et font appel à l’agriculture de précision qui permet de n’utiliser la chimie que dans les quantités indispensables. Si le produit ne délivre pas la promesse « zéro résidu de pesticide », il est disqualifié. Avec un avantage économique pour l’exploitant, puisqu’il ne dépense que la quantité strictement nécessaire. Ces aliments sans résidus de pesticides ne coûtent pas plus cher que les produits conventionnels. Et moins cher que le bio. Il existe donc un potentiel de marché majeur.
Le groupe InVivo, un géant méconnu
Régis : InVivo était le premier groupe coopératif agricole français. Il a récemment franchi un nouveau cap dans la diversification en rachetant le groupe Soufflet, ce qui lui a permis de doubler son chiffre d’affaires et de se positionner dans le Top 3 des groupes agricoles européens. Au-delà de ce changement d’échelle, quelles étaient les motivations stratégiques de cette acquisition ?
Thierry Blandinières : Je vois Soufflet comme un accélérateur du potentiel de création d’InVivo. Nous investissons dans la croissance externe, les technologies, les solutions alternatives aux produits conventionnels comme le biocontrôle. À l’origine, InVivo était juste une centrale d’achat et un bureau de trading, le groupe s’est beaucoup diversifié [NDLR : dans la jardinerie, la distribution alimentaire, le vin, etc.]. Mais notre fonctionnement coopératif a parfois ralenti la mise en œuvre de nos projets. Certaines coopératives adhèrent aux nouvelles idées, d’autres requièrent davantage de temps et d’efforts pour être convaincues. Nous avons mis en place Aladin.farm, une plateforme d’e-commerce qui réunit l’offre de vingt-cinq coopératives ou filiales [NDLR : engrais, semences, etc.]. Cela a été compliqué de le déployer, il a fallu faire preuve de beaucoup de pédagogie. En parallèle d’aladin.farm, nous allons investir massivement sur la plateforme Farmi développée par Soufflet, qui offre des services à 360 degrés aux agriculteurs. Les utilisateurs peuvent consulter la météo, effectuer leurs achats, vendre leurs produits. Et demain, ils pourront comptabiliser leurs crédits carbone, car l’application va tracer et valoriser leur schéma de culture. Bref, nous allons simplifier la vie des agriculteurs. La taille acquise à la suite de l’acquisition de Soufflet nous donne plus de moyens pour financer notre transition technologique. Cela va nous coûter 100 millions d’euros pour aller au bout de Farmi. Il est plus facile d’investir de tels montants quand on affiche 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Les nouvelles technologies nous permettent d’adapter le dosage des intrants
Valentin : Je suis en apprentissage chez Soufflet. Vous l’avez confessé vous-même, si on vous avait dit il y a deux ans qu’InVivo allait racheter le groupe, vous ne l’auriez pas cru. InVivo est une coopérative, Soufflet un négoce privé centenaire. Comment faites-vous cohabiter les deux cultures d’entreprise ?
Thierry Blandinières : Nos cultures d’entreprise ne sont pas si éloignées. Faute de successeur, Jean-Michel Soufflet a cherché un repreneur et il a choisi un acquéreur français. Imaginez le choc politique si Soufflet avait été vendu à un groupe américain ou chinois. Une anecdote : le jour même où nous avons communiqué sur le rachat de Soufflet, le Canadien Couche-Tard annonçait son intention d’acquérir Carrefour. Or le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a bloqué le deal. Soufflet avait rencontré des groupes étrangers, en Amérique du Nord notamment. Il aurait pu privilégier un acquéreur étranger. Bruno Le Maire a salué le rapprochement avec InVivo, qui préserve les intérêts français. Cela dit, vous avez raison, InVivo est une coopérative, Soufflet une entreprise privée. Il faut dépasser nos différences culturelles. En rassemblant nos forces, nous créons une entreprise tricolore de dimension internationale. Il vaut mieux regarder ce qui nous rassemble que ce qui nous divise.
Valentin : Qu’est-ce qui vous rassemble ?
Thierry Blandinières : Nous partageons une mission commune, celle de développer la ferme France. Nous souhaitons améliorer sa compétitivité et aussi le revenu des agriculteurs. Un outil comme Farmi y contribuera. Cela s’inscrit dans la trajectoire de croissance et de diversification d’InVivo. Nous avons hybridé notre système au niveau des mécanismes financiers, mais aussi des idées. Nous avons pratiqué l’open innovation, financé des start-up, nous nous sommes développés au Brésil, aux États-Unis, en Chine, à Singapour… Nous ne manquons pas d’idées.
Mathilde: InVivo veut proposer une « troisième voie entre culture conventionnelle et biologique, basée sur le numérique » (Les Échos, 22 avril). Mais ces outils digitaux ne créent-ils pas une nouvelle forme de dépendance des paysans face aux géants du marché ?
Thierry Blandinières : La technologie agricole repose sur un système d’abonnement. Une application peut cartographier le sol avec des satellites GPS ou des drones, mesurer le potentiel d’une parcelle, observer la biodiversité dans les sols, différencier les endroits où ils sont naturellement humides et ceux où ils sont secs. Les nouvelles technologies et le machinisme agricole nous permettent ainsi d’adapter le dosage des intrants et de traiter les surfaces au mètre carré près. Et d’autres solutions numériques voient le jour. Beaucoup relèvent de start-up qui cherchent leur modèle économique. Un groupe comme InVivo s’intéresse à ces entreprises qu’il peut faire passer à l’échelle supérieure. J’entends votre question sur la dépendance. Mais vous savez, un agriculteur dépend forcément de son écosystème. Sur le volet du financement, par exemple. S’il doit emprunter, il va aller voir le Crédit agricole. Pour obtenir son prêt, il doit fournir un contrat qui justifiera le coût du nouveau bâtiment. Le contrat de la coopérative garantit la marge brute. La banque finance l’investissement et au bout de sept ans de remboursement, le bâtiment appartient à l’agriculteur. Il redevient complètement indépendant et décide ou non de poursuivre avec la coopérative.
Régis : Vous avez évoqué la question de la préservation des sols. Vous avez l’ambition de développer votre filière vin avec une montée en gamme des produits, tout en garantissant une juste valorisation des viticulteurs. Mais le marché est très compétitif. Comment allez-vous vous y prendre ?
Thierry Blandinières : Sur le vin, il y a des zones qui peuvent passer bio à 100 % : le Languedoc-Roussillon, le rosé de Provence. Le climat le permet. À Bordeaux, en revanche, c’est hyper risqué. Vous êtes exposé à un climat océanique, avec beaucoup de pluie et du mildiou. Certains viticulteurs bordelais ont vu leurs rendements chuter de 70 % quand ils sont passés au bio. Dès que vous optez pour des solutions dites naturelles, vous vous exposez à des baisses de production et vous mettez vos revenus en péril. J’ajoute que le bio n’est pas une solution irréprochable. Certains traitements bios utilisent du soufre ou du cuivre, ce qui nuit à la biodiversité des sols. Il faut passer à l’agriculture biologique là où c’est possible, et appliquer les principes de l’agriculture durable ailleurs. Tout n’est pas noir ou blanc.

Un vétéran de l’industrie agroalimentaire
Mathilde: Que changeriez-vous à l’école, du primaire aux études supérieures, pour y intégrer les enjeux liés à l’agriculture ?
Thierry Blandinières : Il faut parler d’alimentation aux jeunes enfants, leur faire comprendre avec pédagogie comment on élève un poulet, leur expliquer que ce n’est pas un « nugget » de chez McDonald’s, si vous me permettez de caricaturer un peu. Il s’agit de leur présenter la chaîne alimentaire, mais aussi de leur apprendre le goût. Je trouve très intéressant que les chefs interviennent dans les écoles et les lycées. La Semaine du goût a été créée il y a plus de trente ans. Il est temps de la revisiter, en allant plus loin. Mais pour créer des ponts entre les mondes agricole et scolaire, il faut remettre en cause la logique de silo au sein du gouvernement. J’ai été président de l’Inria à Bordeaux (NDLR : Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique), nous avons beaucoup discuté de la façon dont nous pouvions faire collaborer les ministères de l’Agriculture, de l’Éducation, mais aussi de la Santé. Il s’agirait d’imaginer un programme commun sur le thème de l’alimentation. Apprendre aux élèves, de la maternelle au lycée et même dans les grandes écoles, à bien se nourrir.
Les jeunes peuvent réinventer le modèle agricole
Régis : Cela fait plus de trente ans que vous travaillez dans l’industrie agroalimentaire. Qu’est-ce qui vous passionne le plus dans votre métier ?
Thierry Blandinières : Je suis sorti de l’école de commerce de Nantes, aujourd’hui Audencia, en 1983. J’ai commencé ma carrière chez Procter & Gamble. Ça vous parle encore ? [Rires] J’étais spécialisé dans les produits de grande consommation : lessives, couchesculottes, shampooings, etc. Cela m’a passionné d’essayer de comprendre ce que souhaitent les consommateurs et d’apporter des solutions en innovant sur le produit et le marketing. Je me suis rapidement tourné vers l’alimentaire. J’ai commencé sur des produits de luxe, le foie gras, le caviar avec Labeyrie. Nous avons voulu nous inspirer de ce que LVMH a fait chez Moët. Bernard Arnault a réussi à créer un numéro un dans les champagnes et les spiritueux. Nous avions l’intention de réaliser une performance similaire sur les produits de luxe solides. Nous avons lancé de nouveaux concepts et attaqué des marchés à l’international. L’alimentation est restée le fil rouge de ma carrière depuis cette époque.
Valentin : Vous dites que vous cherchez à avoir une nouvelle idée chaque jour. Avez-vous un exemple d’une de ces idées qui est devenue réalité aujourd’hui ?
Thierry Blandinières : Je pense à Aladin.farm, la première plateforme agricole. Pour trouver le nom de la marque, je me suis dit qu’il fallait qu’elle commence par un « a », comme Amazon ou Alibaba. Je suis tombé sur Aladin, je me suis dit que c’était pas mal. J’ai immédiatement consulté le service juridique pour savoir où était déposée cette marque. Nous nous sommes aperçus qu’elle n’était pas déposée dans l’agriculture ou l’alimentation. J’ai demandé à préempter la marque, et le soir même nous avions les droits. Nous avons choisi l’extension « .farm » plutôt que « .org » ou « .com » pour souligner l’aspect professionnel.
Régis : Si vous aviez un conseil à donner à la nouvelle génération d’agriculteurs, quel serait-il ?
Thierry Blandinières : Des milliers d’agriculteurs vont prendre leur retraite dans la décennie qui vient. Qui va reprendre leur exploitation et dans quelles conditions ? Les jeunes ont là une opportunité à saisir. Bien sûr, il y aura toujours des agriculteurs qui achètent la ferme du voisin et agrandissent leur exploitation. C’est bien normal. Mais les nouveaux entrants sont aussi les bienvenus. Ils portent un regard différent et intéressant sur le monde agricole. Ils inventent de nouveaux modèles, ils tentent des choses. Comme dans la citation, « ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait ». Les jeunes peuvent réinventer le modèle agricole. Je les y invite de tout mon cœur !
Published by Thomas Lestavel