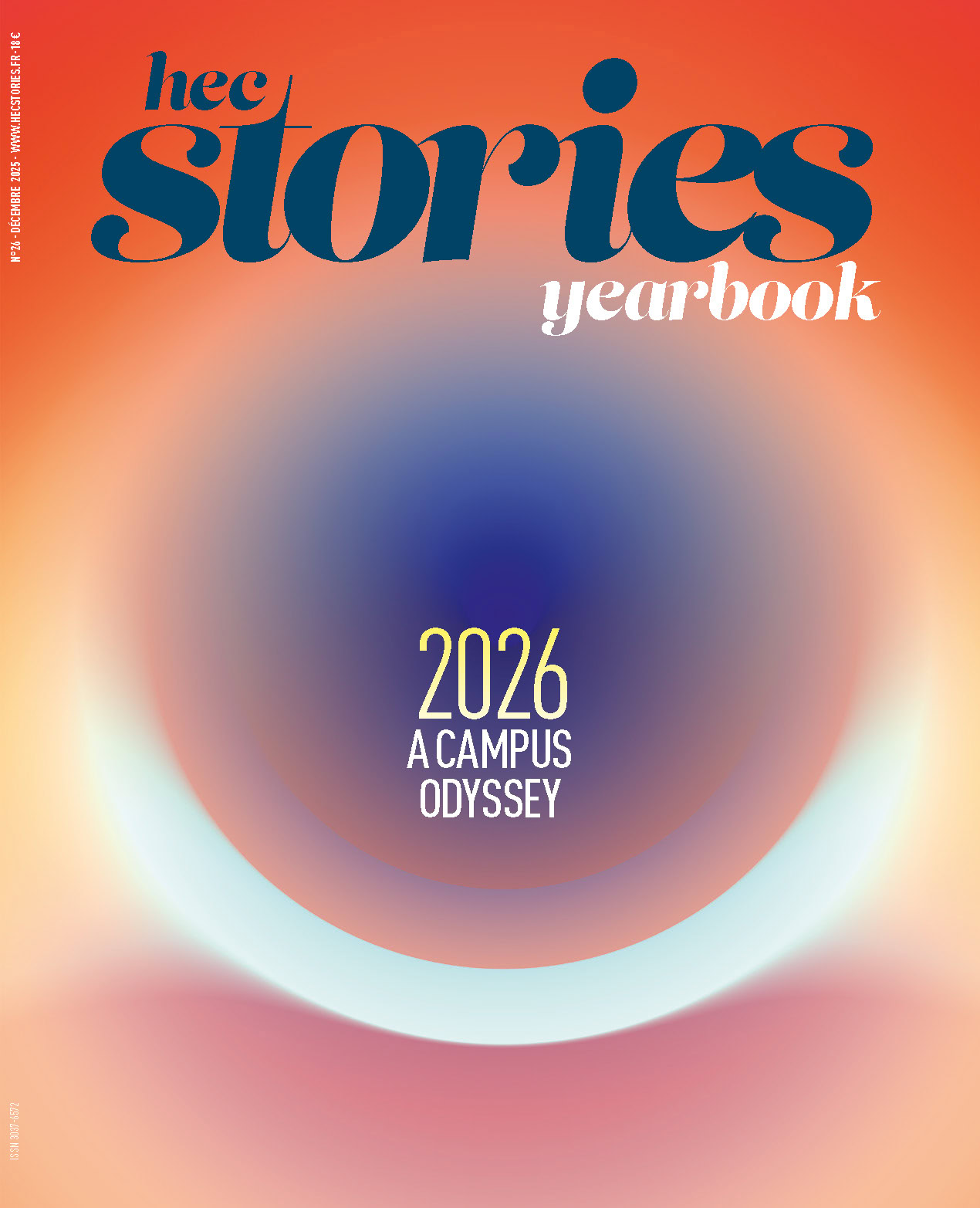Romain Drosne : « L’entrepreneuriat, c’est accepter de ne pas tout maîtriser »

Fondateur de plusieurs startups, dont Plinkers et Justice.cool, Romain Drosne a fait de l’innovation juridique son terrain de jeu. Il revient sur son parcours, les défis de l’entrepreneuriat et l’impact de l’intelligence artificielle sur son secteur.
Justice.cool est une plateforme en ligne qui facilite l’accès à la Justice en simplifiant la gestion des contentieux de masse. Cette start-up française, incubée au sein de Station F, utilise l’intelligence artificielle pour digitaliser et automatiser les processus judiciaires afin d’optimiser l’ensemble de la chaine de valeur. Grâce à l’utilisation de plusieurs types d’IA, Justice.cool propose une solution complète et en conformité avec les exigences de la Justice pour résoudre les contentieux les plus fréquents. Les 30 000 utilisateurs actifs sur la plateforme se situent partout dans le monde et sont aussi bien des particuliers, des corporates ou encore des institutions.
HEC Stories : Vous avez un parcours entrepreneurial riche, avec des entreprises comme Plinkers ou encore Justice.cool. La fibre entrepreneuriale a-t-elle toujours été en vous ?
Romain Drosne : C’est une bonne question. Mais les faits parlent d’eux-mêmes. J’ai monté ma première société alors que j’étais encore étudiant, à une époque où ce n’était pas courant. Aujourd’hui, créer sa boîte jeune est devenu presque normal, mais il y a 25 ans, l’entrepreneuriat n’était pas aussi accessible. Autour de moi, on me disait : « Mais tu es fou ! Tu n’as pas d’expérience, tu devrais d’abord apprendre avant de te lancer. » Il y avait cette idée très ancrée qu’il fallait d’abord faire ses preuves dans une grande entreprise avant d’avoir la légitimité de créer son propre projet. Mais je crois que quand on a cette fibre en soi, on ne peut pas l’ignorer. À l’époque, ce n’était pas une décision très réfléchie, mais plutôt une envie, une évidence. C’est en avançant que j’ai compris que l’entrepreneuriat me correspondait totalement.
Quel est, selon vous, le principal défi lorsqu’on lance une startup ?
R.D : Le plus difficile, c’est de savoir par où commencer et de dépasser ses propres craintes. L’entrepreneuriat, c’est une aventure où on ne sait jamais exactement ce qui nous attend, et c’est souvent cette incertitude qui fait peur. On se retrouve face à des problématiques complexes, qu’elles soient techniques, financières ou personnelles, et on se rend compte qu’il y a beaucoup plus d’inconnues que prévu. Ce qui peut freiner beaucoup de gens, c’est l’envie de bien faire, d’avoir tout parfaitement planifié avant de se lancer. Pourtant, vouloir tout maîtriser, c’est souvent ce qui empêche d’avancer. À l’école, on nous apprend à viser le 18 ou le 20 sur 20, à ne pas rendre un travail tant qu’il n’est pas parfait. Mais en entrepreneuriat, il faut accepter de faire du 12/20 au début, sinon on stagne et on perd du temps. Il faut avancer, tester, apprendre de ses erreurs et ajuster en permanence. Et puis, il y a aussi un aspect émotionnel : il faut être prêt à encaisser les doutes, les échecs et les critiques. C’est un vrai marathon, où l’important n’est pas d’être parfait dès le départ, mais d’être capable de tenir sur la durée et d’évoluer en permanence.
Justice.cool a été incubée à Station F. En quoi cet environnement a-t-il aidé votre développement ?
R.D : Nous avons rejoint l’incubateur HEC à Station F en 2019, juste avant le Covid. Malheureusement, la crise sanitaire a limité les opportunités d’interaction sur place, mais nous avons quand même bénéficié d’un écosystème entrepreneurial extrêmement riche. Ce qui est précieux dans un incubateur, c’est la proximité avec d’autres startups qui rencontrent les mêmes problématiques. Échanger au quotidien avec des entrepreneurs qui traversent des défis similaires permet d’éviter de nombreux écueils. Parfois, on pense qu’on est seul face à un problème, alors qu’en réalité, d’autres ont déjà trouvé des solutions et peuvent nous aiguiller. L’incubateur, c’est aussi un formidable accélérateur en termes de ressources et de conseils. On découvre des outils, des services, des experts qu’on n’aurait peut-être jamais pris le temps de chercher soi-même. Par exemple, dans la gestion comptable ou administrative, on peut facilement perdre du temps à tester différentes solutions. Mais en parlant avec d’autres entrepreneurs, on bénéficie directement de leurs retours d’expérience et on peut faire des choix plus rapidement.
Vous avez repris des études en médiation et négociation en 2019. Cela a-t-il influencé la création de Justice.cool ?
R.D : En réalité, c’est plutôt l’inverse. Nous travaillions déjà sur des modes alternatifs de résolution des litiges lorsqu’une nouvelle loi sur la médiation est entrée en vigueur. Cette loi nous est tombée dessus presque par hasard, en mars 2019, et nous avons immédiatement vu qu’elle correspondait exactement à ce que nous étions en train de développer. Mais pour pouvoir l’exploiter pleinement, il était essentiel de maîtriser en profondeur ses mécanismes. C’est pour cette raison que j’ai décidé de me former en médiation conventionnelle à l’Institut Catholique de Paris, puis en médiation de la consommation à l’EPMN. Pendant cette période, nous avons fait évoluer notre vision et notre produit pour nous aligner avec cette nouvelle réglementation et en faire une véritable opportunité.
Comment fonctionne Justice.cool et en quoi cette startup révolutionne-t-elle la gestion des contentieux ?
R.D : Justice.cool est spécialisée dans l’industrialisation des processus contentieux. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, nous ne nous limitons pas à la médiation : c’est un des services que nous proposons, mais notre activité est beaucoup plus large. Nous permettons aux avocats, greffiers, huissiers ou associations de consommateurs d’automatiser la gestion de milliers de dossiers. L’idée est simple : un avocat peut gérer seul quelques dossiers, mais quand il doit en traiter des centaines ou des milliers, ça devient ingérable. Nous avons conçu une solution qui couvre toute la chaîne de valeur, de l’identification des clients jusqu’à l’exécution des décisions de justice. Nous collaborons aussi avec des tribunaux pour optimiser la production des décisions. C’est une transformation profonde du secteur juridique, qui permet de rendre la justice plus efficace et plus accessible.
Quels sont vos projets pour l’avenir de Justice.cool ?
R.D : Nous sommes en constante évolution, et l’intelligence artificielle a bouleversé notre activité ces dernières années. Lorsque nous avons commencé à travailler sur le projet Justice.cool en 2017, nous étions déjà convaincus du potentiel de l’IA dans le domaine juridique. Mais l’arrivée de ChatGPT en 2022 a tout remis en question. Nous avons dû repenser une grande partie de notre produit pour intégrer ces nouvelles avancées. C’est une dynamique permanente : l’IA évolue à une vitesse fulgurante, et nous devons sans cesse nous adapter pour rester à la pointe. Par exemple, nous travaillons actuellement sur des agents conversationnels spécialisés dans l’accompagnement des victimes de soumission chimique. Ce sont des chatbots capables de répondre immédiatement aux victimes, 24h/24, pour leur donner les bons réflexes à adopter en urgence. C’est un besoin crucial, car les drogues utilisées dans ces contextes disparaissent très rapidement de l’organisme, et un simple retard dans les analyses peut rendre toute preuve impossible à établir.
Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait se lancer ?
R.D : L’entrepreneuriat, c’est accepter de ne pas tout maîtriser. Il faut être prêt à renoncer au confort d’un emploi stable avec un salaire assuré et des perspectives de carrière bien définies. Se lancer, c’est faire le pari de l’inconnu, accepter de prendre des risques et de vivre avec une certaine forme d’incertitude. Et aujourd’hui, avec l’essor de l’intelligence artificielle, tout change encore plus vite. Il faut être conscient que les cycles de vie des produits se raccourcissent énormément : un projet qui semblait solide peut devenir obsolète en quelques mois si un concurrent utilise mieux l’IA que nous. L’important, ce n’est pas d’avoir un plan parfait, mais d’être capable d’apprendre vite et de s’adapter en permanence. C’est un défi, mais c’est aussi ce qui rend cette aventure passionnante.
Published by Loane Gilbert