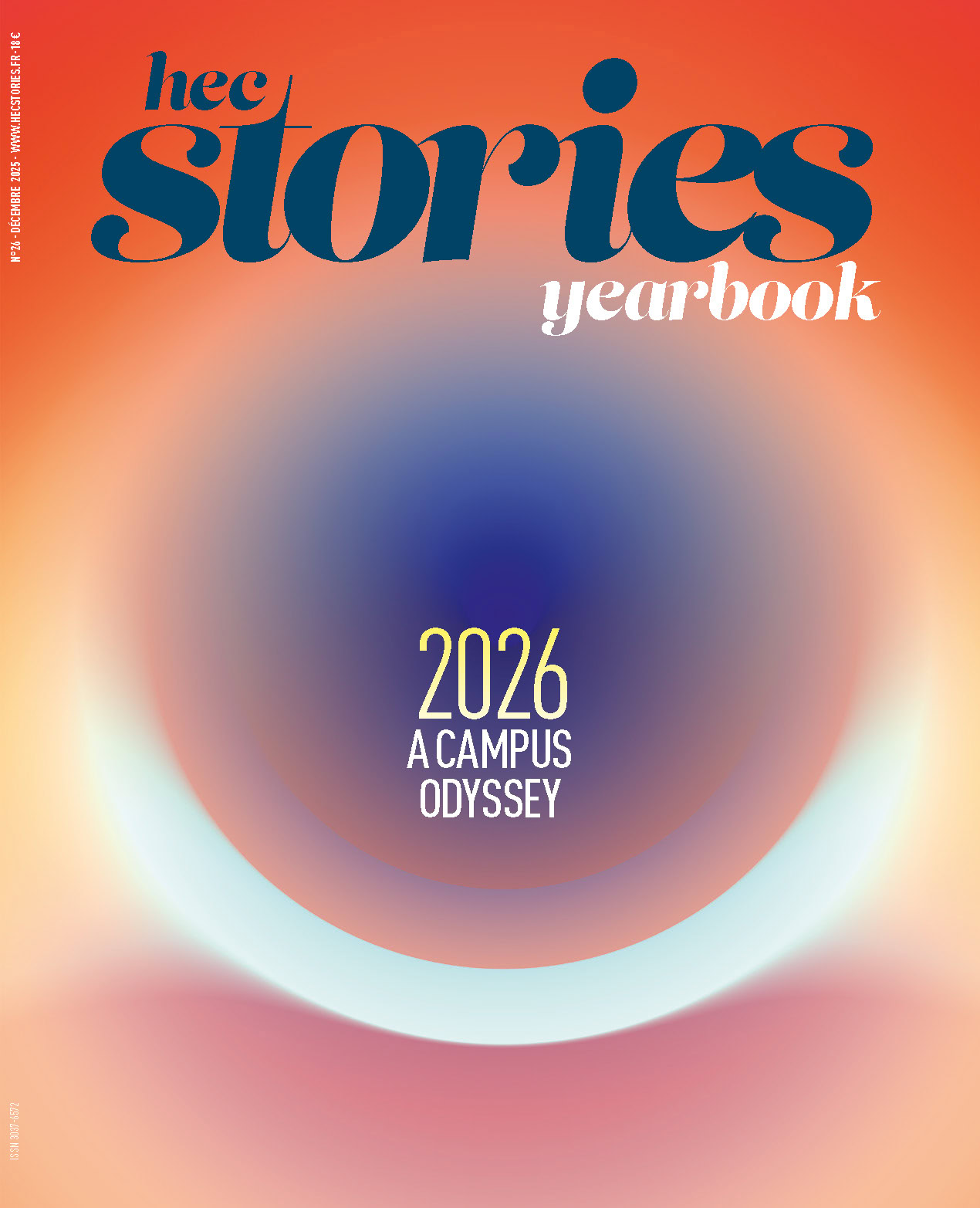Thomas Paris, professeur à HEC : “Faute d’un leadership fort, la dynamique d’innovation peut s’éteindre”

La création dans la mode n’est pas une affaire de génie mais un travail collectif, où le manager tient un rôle crucial. Les explications de Thomas Paris, professeur à HEC Paris et chargé de recherches au CNRS.
Vous avez développé une expertise sur les industries créatives. La mode fait-elle partie de cet univers ?
Avant d’y répondre, il faut préciser ce que ce terme recouvre. Il y a au moins trois définitions. En France, on parle d’industries culturelles et créatives (ICC), pour intégrer des domaines comme la mode et les jeux vidéo qui sont parfois vus comme périphériques aux secteurs culturels.
La définition académique, elle, date de la fin du XXe siècle : l’économiste américain Richard Caves propose le concept d’industries créatives, pour désigner les secteurs qui placent la création au cœur de l’activité. La mode en fait partie.
Enfin, une définition plus « politique » nous est venue d’Australie, puis a été reprise au Royaume-Uni avant de s’étendre dans l’Union européenne. La notion d’industries créatives a été mise en avant pour englober un certain nombre de secteurs qui présentaient des caractéristiques intéressantes du point de vue économique : forte intensité de main-d’œuvre, haute valeur ajoutée, capacité à se différencier par le haut. En Europe, ces enjeux ont donné lieu à la notion d’économie de l’immatériel, dont elles seraient une composante.
La mode y a toute sa place : une part importante de son chiffre d’affaires repose sur sa capacité à proposer en continu des produits nouveaux, dont la valeur est déterminée par des critères subjectifs et culturels.
L’imaginaire collectif associe la création à une figure romantique, celle de l’artiste solitaire, inspiré. Mais dans les faits, la création est toujours le fruit d’un travail collectif, organisé et structuré. Comment coordonner et manager tout ça ?
Le rôle du créateur ou de la créatrice est central, mais pas dans toutes les étapes. L’idéation — la phase d’inspiration — peut être confiée à des équipes. Le moment crucial, c’est celui de la validation : dire « oui » ou « non ». Cette étape porte beaucoup d’enjeux, car personne ne peut affirmer avec certitude si une idée est bonne ou mauvaise. Il faut donc un décideur final, capable de maintenir une direction contre vents et marées. C’est ce que font, chacun à leur manière, Olivier Rousteing chez Balmain, Maria Grazia Chiuri chez Dior ou Nicolas Ghesquière chez Louis Vuitton.
Le plus difficile, c’est de résister à tous ceux qui, consciemment ou non, vous ramènent vers ce qui existe déjà. Il faut assez d’ego, mais un ego « sain », pour assumer d’emmener l’organisation ailleurs.
Comment se passe-t-il concrètement ?
Je distingue quatre étapes dans le processus de création.
- L’inspiration ou idéation. C’est la phase d’ouverture. Certaines marques envoient leurs équipes dans des musées ou des expositions d’art contemporain. Lorsqu’il était chez Dior, John Galliano partait en voyage avant chaque collection. De retour d’Argentine, il ramenait, par exemple, l’image du gaucho dans la pampa. On peut aussi s’inspirer du marché via le « shopping », le repérage en boutiques, plonger dans les archives, ou encore visiter les ateliers traditionnels comme le fait De Bonne Facture, la marque fondée par Déborah Neuberg (H.07).
- Le cadrage. Qui décide des orientations ? Si c’est le marketing, la marque risque de rester collée à l’existant. Si c’est le créateur, elle peut sortir des sentiers battus. C’est là que l’audace commence.
- La mise en forme. Moodboards, croquis, maquettes : on matérialise peu à peu une vision encore conceptuelle. C’est une phase d’alignement collectif autour d’une idée.
- Et enfin, la validation. L’étape à la fois la plus simple — dire oui ou non, plus généralement réorienter — et la plus complexe, car elle engage toute la direction créative.
On comprend bien l’importance du créateur. De ce fait, sa succession constitue un sujet sensible et complexe…
Oui. C’est une question importante, que j’ai beaucoup étudiée, et qui revêt des enjeux différents dans des cas comme Maison Martin Margiela et Jean Paul Gaultier. Le départ d’un créateur constitue toujours un moment critique. Dans la mode, les équipes ont certes l’habitude de travailler avec des « chefs d’orchestre » qui sont renouvelés régulièrement. Mais il existe un risque, notamment dans la succession du créateur-fondateur : celui que le successeur ou l’organisation soient tétanisés par la figure du créateur et le respect exacerbé de sa ligne éditoriale. La dynamique d’innovation peut s’éteindre, faute d’un leadership fort.
On parle beaucoup d’intelligence artificielle (IA) en ce moment. La mode est-elle une industrie propice à l’innovation ?
Cela dépend de quoi on parle. Les innovations « produit » de type vêtements connectés ou textiles intelligents ont peiné à s’imposer. En revanche, la conscience écologique bouscule les pratiques et pousse des marques à remplacer la fourrure animale ou certains matériaux en raréfaction.
L’innovation se joue aussi dans les processus. L’IA, par exemple, s’installe à une vitesse fulgurante dans beaucoup de secteurs, bien plus rapide que le numérique à son époque. Elle peut notamment aider la phase d’inspiration.
En analysant, par exemple, les goûts des internautes sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok ?
Tout à fait. Il faut trouver le bon curseur entre proposer une création audacieuse et coller au marché. Dans le modèle romantique, le créateur s’isole et livre sa vision : « Voilà ma collection, à prendre ou à laisser. » Cela peut fonctionner dans la haute couture, où le pouvoir de prescription reste fort. À l’opposé, on teste, on mesure, on répond à une attente déjà formulée. C’est le cas dans le parfum, par exemple. On innove peu. Mais comme le disait Steve Jobs : « Si vous demandez aux gens ce qu’ils veulent, ils vous donneront la réponse d’hier. »
Le bon positionnement se situe entre les deux.
Quels sont les freins à l’innovation dans la mode ?
Les raisons sont souvent structurelles : des exigences de rentabilité à court terme, la pression d’actionnaires impatients, des cycles financiers rapides. Le contexte organisationnel est déterminant. Les entreprises non cotées, celles qui ont des actionnaires de long terme, bénéficient à ce titre d’un avantage. Je prends souvent l’exemple de Pixar dans le cinéma. Avant son rachat par Disney, la société combinait la stabilité de son actionnariat (avec Steve Jobs) et la compréhension fine d’Ed Catmull de ce que signifiait la création, et des conditions de son épanouissement.
Un pouvoir de décision reposant sur un seul individu, n’est-ce pas problématique ?
Francis Ford Coppola disait que réalisateur est peut-être l’un des derniers postes « dictatoriaux » dans une société démocratique. Paul Andreu parlait de l’architecte comme d’un « tyran ». Et pour se moquer du tout-collectif, l’humoriste Francis Blanche disait : « un chameau est un cheval dessiné par une commission ».
Je pense qu’on peut défendre une forme de « dictature » créative, au sens d’un décideur final, si l’on veut véritablement préserver la part de subjectivité et d’audace dans la création. À condition de poser des garde-fous.
C’est le prix à payer pour que la création conserve son pouvoir de surprise et sa capacité à ouvrir des mondes nouveaux. Mais attention à ne pas confondre autorité créative et abus de pouvoir. Certains créateurs, comme John Galliano, ont franchi cette ligne — et en ont payé le prix.
Published by Marianne Gérard